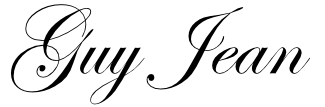(photo : Sue Mills)
«Guy Jean : poésie en chemins»
Paul Mathieu, poète et critique littéraire belge
D’une rive à l’autre de l’Atlantique, la même ferveur et les mêmes interrogations requièrent les poètes accoudés au bastingage d’une société partie depuis longtemps à la dérive. Pour eux, ne comptent ni les distances ni les idiomes quand ils sont d’abord à l’écoute du monde et de sa respiration. Quand ils perçoivent mieux que quiconque le vacarme des bombes. Quand ils connaissent le prix des mots que l’on refuse d’entendre. Quand ils persistent à parler seuls au milieu des foules trop affairées pour prêter attention à l’essentiel. C’est à cette race-là qu’appartient Guy Jean, poète de l’Outaouais et de l’universel.
Révolutionnaire ? Peut-être, mais de neige et d’ailleurs. Pas dans les barricades, mais dans la vie même, dans la parole de tous les jours. Si, dès 1962, il récitait ses poèmes dans les « boîtes à chansons » d’Acadie, Guy Jean avait déjà la contestation tranquille, tempérée par un regard sans complaisance sur ses contemporains… Pour lui, tout a commencé avec des Coups de paroles au cul. S’exprimer, c’est ce qui importait en priorité, oser prendre la parole, malgré les shhhh / laisse parler les grands / tu sais pas c’que tu dis / ferme ta yeule. Du coup, il n’a jamais hésité à faire bouger les choses dans un discours de plus en plus serré qui a évolué à l’occasion vers des formes extérieures à toutes les normes et à toutes les conventions. Réadaptant la voix de l’homme à celle des éléments, il parle fleuve, il parle morse, il parle hiver, il parle hors des âges. Il parle aussi pour tous ceux que nul n’entend ou ne veut entendre.
L’identité en bannière, dressé contre les puissants, militant du rapprochement entre les peuples, il construit une œuvre qui crie fort sans pourtant souffler un mot de trop. Et si l’écrivain peste parfois contre le clergé, il n’en reste pas moins ouvert aux spiritualités de tout ordre quand il reprend Hafez : Mon cœur, viens-t’en, nous nous réfugierons en Dieu, / loin de ce qui fait manche courte et bras long.
Il y a du trappeur chez lui, mais un trappeur de l’impossible qui entend parcourir le monde à la recherche de ses traces anciennes. Avec lenteur, il déchiffre alors les signes cueillis au-delà de tous les efforts de communication. En plusieurs occasions, c’est l’élément liquide qui l’interpelle : la rivière avec ses arabesques, ses chevelures d’algues abandonnées dans le courant et ses dessins changeants que l’on tente d’interpréter comme pour y découvrir quelque volonté cachée. À l’envi, les expériences se mélangent, les siennes propres et celles des artistes qui l’accompagnent parfois comme Janet Fredericks ou Edmond Baudoin. Dans un éternel voyage, il s’agit en quelque sorte de dire l’ailleurs, mais cet ailleurs qui commence dès les terres frontalières du quotidien. Nager alors à contre-courant, contre la mort, mais aussi dans le sens de la poésie quand elle parle d’elle-même : si le parcours débute aux bords du ruisseau le plus humble, il s’en va finalement plonger dans les abysses inexplorés où croisent des poissons hallucinés et des mystères insondables.
Pour lui, il faut voir autrement et retrouver les origines. Ainsi, le questionnement constant de l’enfance ou le chant du chaman, angoqoq qui fredonne aux esprits des mots secrets pour qu’ils couvrent d’yeux mon corps. Il faut devenir pierre par le retour à la niche maternelle et, plus loin encore, creuser vers les traces primitives, vers l’écriture première et les musiques d’Ougarit.
À côté de scènes reprises à l’ordinaire, empruntée au souffle chaud du sang ou, à l’inverse, à celui de la neige, l’interprétation de la réalité, qu’elle soit naturelle, culturelle, historique ou sociale, se fait à plusieurs niveaux. On glisse du connu à l’inconnu, imperceptiblement – automatiquement pour ainsi dire – pour se nourrir de ce qui est là, à portée de la main : le printemps au pays, les givres, les vols d’oies sauvages, la mémoire d’ici présente dès le texte liminaire du premier recueil… Des pages d’histoire se tournent au travers de tout ce qui compose un paysage dont on ne voudrait jamais sortir. Des portraits de famille, des instants particuliers se succèdent : ainsi, par exemple, ces Spud au menthol que fumait grand-mère offrant leurs vapeurs d’autrefois comme autant de pèlerinages aux lieux de naissance. Souvent, c’est l’image maternelle qui s’imprègne avec constance, précédant d’autres figures accueillantes et rassurantes. Ici on notera en particulier l’importance des rêves, des secrets de l’enfance qui parlent à contre-courant pour mieux s’agripper à la vie.
Hélas ! la plénitude a ses limites. Sans trop insister, laissant venir vers lui les images des souvenirs précis, Guy Jean renoue avec les guerres et les massacres, dénonçant les coupables désignant les innocents : les drapeaux divins de la guerre / fuient les nuits tristes des enfants. Très vite alors surgit l’innommable : les cendres d’Hiroshima et celles des camps d’extermination devant lesquelles on ne peut que s’incliner et offrir ses larmes. Jamais séparé des barbelés fichés dans les chairs tout autant que dans les mémoires, l’œil rivé en permanence sur les blessures, sur les bombardements de Bagdad, sur la guerre en Palestine, sur le siège de Sarajevo, sur les couloirs d’Auschwitz, Guy Jean rappelle que ça pourrait nous arriver aussi tant, comme l’écrivait Bertolt Brecht, il est encore fécond le ventre d’où a surgi la bête immonde.
La confrontation de valeurs ne passe d’ailleurs pas seulement par les arcanes de la géostratégie, mais peut à l’occasion surgir au coin de la rue envahie par des véhicules dont les chauffeurs n’accordent pas même un regard au pauvre type qui cherche un endroit où ne pas mourir.
Répondant à cette partie sombre, voilà aussi des volets plus lumineux consacrés au désir. En effet, même si, de façon chronologique, Guy Jean met en exergue la violence des mâles (Il y aura homme pour cueillir l’adolescente fraîche, venger le garçon humilié dans son envie de filles impossibles), cela ne l’empêche heureusement pas, de temps et temps, de laisser quelque matière à espérance. On le constate avec cette recherche du Corps d’enfant en mal d’amour. Toujours, derrière la tristesse, une présence féminine apporte sa consolation, comme si l’amour débordant dressait des barrières contre l’abominable, aidait à tenir bon en dépit de la lucidité que ne manque jamais d’entretenir le contact avec l’expérience quotidienne.
Plusieurs livres accentuent cet autre versant du travail de celui qui, malgré les atrocités innombrables, malgré les larmes, malgré tout, se veut ivre de vivre. À côté du désir lié à la danse ou au tatouage du rire, voilà aussi pour de bon l’acte d’amour quand, annoncée par un air d’Éric Satie, s’avance la femme aimée : Dans les draps fleuris / tu refuses le matin / attends celui des rêves.
Au total, l’extrême rigueur de la composition des recueils bat en brèche la liberté des formes et des images qui tendent, tantôt vers l’onirisme ou l’abandon sensuel, tantôt, on l’a souligné, vers une mise en garde toujours d’actualité. C’est donc bien d’un cheminement dont il est question la plupart du temps, nombre d’indices convergent dans ce sens, jusqu’au titre du dernier recueil – En Partance – qui ouvre à cette notion de mouvement, même si ce livre sonne aussi comme une manière de bilan. Il est vrai que, derrière l’acte de communication, au-delà des dénonciations de l’abject ou au-delà des éblouissements de l’amour, la poésie renoue sans cesse avec la quête de soi, là où le rimbaldien je est un autre n’est jamais loin : En lui, je connais ce que je ne vois pas / les traits me servent de signal.
Poésie pour survivre et pour se chercher ? Poésie pour se trouver et pour vivre ? Tout cela à la fois sans doute et bien plus encore.
(2010)